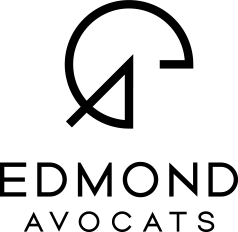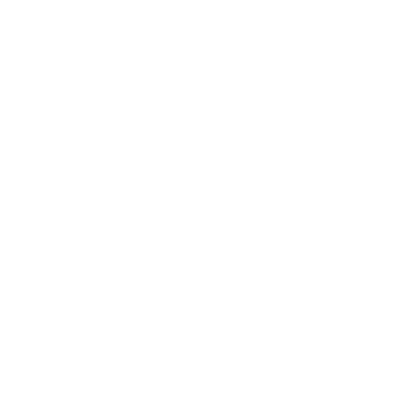En procédure pénale, fixer un délai est un subtil jeu d’équilibriste. En enfermant son action dans un temps à ne pas dépasser, la puissance publique limite volontairement son penchant répressif. Elle s’attache un bras dans le dos pour assurer l’équité du jeu judiciaire. La commodité des organes de poursuite et l’efficacité de leur action en sont nécessairement affaiblies. L’équilibre entre commodité et liberté est par nature instable et impose un rééquilibrage permanent. La présente affaire en est l’illustration parfaite.
Repartons du contexte juridique. Jusqu’en 2004, aucun fondement n’encadrait le délai qui s’écoule entre la fin de garde à vue et la présentation effective de l’intéressé devant un magistrat du siège ou du parquet. Des raisons pratiques (transfert vers le palais de justice, horaire tardif de levée de garde à vue…) ont fait naitre la méthode du « petit dépôt ». Elle consiste à maintenir dans les locaux du tribunal une personne dans l’attente d’une comparution qui ne peut se faire immédiatement. Saisie de moyens de nullité critiquant cette situation de non-droit, la Cour de cassation les rejetait dans l’immense majorité des cas (Crim. 9 févr. 2000 ; Crim. 25 oct. 2000) dès lors que le délai ne justifiait pas les « nécessités du service » (pour un délai de 17 heures : Crim. 9 juill. 2003).
Frustrés, des plaideurs s’en sont remis à la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans sa décision Zervudacki c/ France, les juges de Strasbourg constataient qu’aucune disposition législative n’encadrait la pratique du « petit dépôt » (§ 41). Ils s’émouvaient surtout du fait qu’au cours des 13 heures et 30 minutes qu’avait duré le maintien dans les geôles du palais, la requérante n’avait pu «ni se laver, ni se restaurer, ni se reposer, alors qu’elle venait de subir une garde à vue de quarante-huit heures dans des conditions comparables» (§ 48). La France était logiquement condamnée sur le fondement de l’article 5, § 1, de la Convention, qui protège le droit à la liberté et à la sûreté.
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004, dite Perben II, a donc créé les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale. Désormais, la personne déférée doit comparaître devant le magistrat le jour où sa garde à vue prend fin. Par dérogation au droit commun, l’article 803-3 autorise, « en cas de nécessité » une comparution « le jour suivant ». Cette nécessité doit être justifiée par des contraintes matérielles (Crim. 13 juin 2018). A cette fin, l’intéressé est retenu « dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ». Différentes garanties, pour certaines similaires à celles édictées pour la garde à vue (avocat, médecin, alimentation…), sont prévues au profit de l’intéressé.
Dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel avait mis en garde le législateur. S’il est possible de retenir au « petit dépôt » une personne dont la garde à vue a été prolongée par le parquet, c’est à condition que l’intéressé soit présenté à un magistrat du siège, et non du parquet, avant l’expiration du délai de vingt-heures.
Une question restait en suspens : cette comparution devant le magistrat du siège doit-elle revêtir une forme particulière ?
L’affaire qui nous occupe y répond. Faute d’escorte disponible, le juge d’instruction suit un modus operandi assez artificiel, dans le seul but d’interrompre le délai de l’article 803-3 du code de procédure pénale. Il relève l’identité de la personne déférée puis, deux minutes après le début de cet interrogatoire, inscrit au procès-verbal : « vu l’heure de levée de garde à vue l’impossibilité de nous présenter la personne visée dans le délai imparti, interrompons le délai à 13h57, indiquons au mis en cause que nous le réentendrons plus tard dans l’après-midi pour procéder à son interrogatoire de première comparution ». L’interrogatoire reprend plus d’une heure après, soit après l’expiration du délai légal.
L’arrêt commenté valide ce procédé. Le magistrat instructeur peut donc interrompre le délai de vingt heures par une simple constatation d’identité et ce, sans même s’embarrasser de la présence d’un avocat. Il faut reconnaître que ce raisonnement, que nous qualifierons sobrement de pragmatique, tient compte du contexte parfois délétère dans lequel travaillent les magistrats instructeurs. Les contraintes de service, liées notamment aux difficultés d’obtenir des escortes, se généralisent. Elles troublent le travail du juge et l’obligent comme ici à inventer des artifices pour éviter des remises en liberté intempestives.
S’il n’est pas question de minimiser l’importance de ces contraintes, on s’inquiétera de ce qu’elles imposent une lecture crispée des textes protecteurs des libertés individuelles. L’article 803-3 du code de procédure pénale est déjà un texte d’exception, unecommodité offerte aux magistrats pour faire face aux contraintes matérielles qu’ils rencontrent. En autorisant le juge à déroger artificiellement à la dérogation, la Cour de cassation érige les contraintes de service en mètre étalon des libertés individuelles. Le juste équilibre n’aurait-il pas consisté à demander au juge d’instruction un contrôle moins mécanique de la situation ? Par exemple, en s’assurant a minima que les droits de la personne maintenue dans les « petites geôles » depuis près de vingt heures ont été respectés ou même notifiés ? L’arrêt ne s’intéresse pas à la question de savoir si l’intéressé a pu s’alimenter, s’il a vu un médecin et un avocat, s’il a pu téléphoner à un proche… Autant de droits dont l’intéressé ne reçoit pas notification mais qui sont pourtant prévus par l’article 803-3 du code de procédure pénale et auxquels la Cour européenne des droits de l’homme s’était montrée attentive dans l’arrêt cité plus haut. La Constitution a érigé l’autorité judiciaire en « gardienne des libertés individuelles ». Ne laissons pas les contraintes de service réduire cette formule à une simple incantation.